
LES INCENDIES DE BAYONNE
Anne-Marie Bellenguez
 Cet essai englobe quelques uns des incendies que Bayonne eut à subir au cours de son histoire..
Cet essai englobe quelques uns des incendies que Bayonne eut à subir au cours de son histoire..
Pour effectuer cette étude, il a fallu accepter un postulat , à savoir que chaque arrêté de prévention découvert en Archives est déjà la conséquence de drames, d'échecs, peu ou pas relatés mais qui jouent un rôle essentiel dans le bilan à dresser. En effet, les incendies ne se trouvent souvent répertoriés que lorsqu'il y a une intervention financière de la ville :
- Parce que l'incendie a touché un bâtiment public
- Lorsqu'un acte de malveillance ou pénalisable donne lieu à des poursuites,
- Lorsque les sinistrés réclament quelques secours.
L'étude couvrant les périodes anciennes ne peut donc être qu'une simple illustration, ni chiffrée, ni exhaustive, des difficultés et des réactions d'une ville industrieuse, face au coup du sort de l'incendie.
Depuis 1974, au contraire, les sapeurs-pompiers présentent une information précise, traitée avec des outils performants, la statistique et l'informatique.
Les Causes des incendies
Smblables à celles de nos jours, peuvent étre classifiées en imprudences, causes climatiques, malveillance ou incendie politique .
- Une belle illustration d'imprudence est celle de l'incendie qui, en 1736, ravage tout un quartier du centre de la ville, la rue du Pont-Mayou et la rue d'Ouesque. Parti de la maison d'un droguiste-épicier qui préparait des confitures sèches, le feu ravage une vingtaine de maisons et fera de nombreux morts...
C'est un gamin, commis de magasin, qui avait pour charge d'éteindre le feu sous les confitures avant d'aller dormir. Il les oublie et le feu gagne les produits combustibles entreposés dans la boutique, dont un baril de poudre ! Ce fut l'épouvante et l'incendie dura 5 jours. (DD156 et DD 160 11). Cette catastrophe de 1736 déclenchera une série de mesures draconiennes due au stress collectif mais les incendies seront encore « quasi journaliers ».
- Les accidents dus aux feux de cheminée sont fréquents. On comprend mieux en suivant, les experts dans leurs visites des maisons. Ils en donnent des descriptions étonnantes : Des foyers sont à même le plancher, sans tuyau. "Sur le ciel du lit tout proche sont entassés de petits fagots , les hardes sont près du feu ..." en 1709,(DD 156 15), en 1745,(DD 157) ,
En 1740, lors des visites de contrôle, on citait déja la Maison "Latour", où il n'y avait aucun tuyau de cheminée, le feu étant à même le plancher.
Dans la maison de la Demoiselle Lissonde, trois foyers sur le plancher, sans cheminée ni tuyau ( 1724 1731 CC 195)
Idem pour la maison de la veuve Lafleur ou la maison de Duvege au bout de la rue Pannecau, etc.
Dans l'une d'elles ce sont des tables qui servent de tuyau et de là "les bluettes et la flamme du feu peuvent s'élever jusqu'au toit"(DD 156 91- 92). 03.02.1741 Le tuyau de la maison Destandau ne peut être ramoné, il n'y a qu'une petite ouverture pour recevoir la fumée. Il devra impérativement être agrandi avant le 10.02.1741.
Cet état d'inconfort qui nous stupéfie, mais est si fréquemment cité , résulte d'une économie fiscale : Pour ne pas être taxé par "feu", on ne construisait pas de cheminée!
Rien d'étonnant à ce le maire Dulivier se plaigne le 02 juin 1741 d'accidents fréquents et presque journaliers, dus au manque de nettoiement des cheminées. Il en impute en grande partie la faute aux propriétaires qui ne se soucient pas de la propreté des cheminées puisque l'on fait supporter l'amende aux locataires en cas de feu. Dorénavant, les propriétaires paieront l'amende si leurs locataires s'avèrent insolvables . (DD 156 93).
- De même l'arrêté portant prohibition d'allumer quelque feu la nuit sur les navires est maintes fois réitéré. Il faut dire que la technique de calfatage des bateaux représentaient un danger réel d'incendie .
Il fallait chauffer du goudron puis flamber la coque du navire pour faire adhérer le brai, l'enduit de revétement et... " Il n'est pas toujours au pouvoir des hommes de limiter la flamme d'un feu qu'il met"!
Le 01.05.1741 (DD 156 92), le capitaine breton François Dunau chauffe du "bré"dans la cale où il a établi une chaudière. Le feu qui a pris a été rapidement éteint, mais il écope tout de méme de 50 livres d'amende.
Seront interdits également les lancements de fusées ou les feux pour la St-Jean. Celui devant la cathédrale suffit !(DD 160 58 23.03.1744). En 1744 (DD 157) .
Les moyens de propagation :
A l'origine de l'Etablissement de Bayonne, Les toits étaient de chaume, nous dit Duceré et recouvraient des maisons en bardeaux, très rapprochées .
1258 semble une année dramatique où des quartiers entiers disparaissent en quelques heures.
C'est le grand incendie de 1290 qui, toujours d'après Duceré, marque une date dans le désir de la prévention.
Pourtant Vauban, qui, en 1681 étudie la construction de la Citadelle , craint encore un embrasement, selon lui inévitable en cas de siège, à cause des charpentes en bois, des encorbellements, des rues resserrées.
Sans compter les produits inflammables qui s'accumulent dans les arrières boutiques etconstituent un risque permanent.
Causes climatiques
La foudre frappe la cathédrale en 1660, en1701,en 1741, en 1755.etc.. (Duceré, Histoire de Bayonne) Dès 1310, une bulle papale de Clément V atteste que la cathédrale de Bayonne a été anéantie par la foudre. (Bayonne Elie Lambert 1958).
Malveillance, le crime d'incendiaire
- Une nuit de 1752, Elie Brandon, commerçant rue du Port Neuf, perce le mur du de la boutique d'Abraham Lévi son voisin et s'y sert en marchandises. Ensuite il place dans le magasin une chandelle allumée qui devra mettre le feu, referme le trou et rentre chez lui. Mais une lueur dans un magasin fermé donne l'alarme. Il y a vite un attroupement, la descente du Maire et de Messieurs les officiers du Sénéchal.
Grâce à la rapidité de l'alarme, la catastrophe sera évitée. Mais Brandon, au nom prédestiné, accusé de crimes d'incendie prémédité et de vol avec effraction voit son cas est aggravé. En effet, de nationalité juive, il ne devait quitter les murs de Bayonne avant la nuit tombée. (FF 504.15 à 27).
- C'est encore un incendiaire qui, en 1723 (DD 156 18 ) embrase une partie de la digue du Boucau. Le feu a été alimenté de loin en loin par de la paille ...
- En 1735, Navarret, préposé à la garde des pignadars, découvre qu'une personne mal intentionnée a mis le feu à du bois fraîchement débité, (l'équivalent d'une charrue et demie) et les flammes ont gagné sur 7 ou 8 pins sur pied.
- Un autre sinistre, attribué à de la malveillance détruit, le 22 avril 1824 , le château de Marrac, propriété de Napoléon I˚. il y passa trois mois au milieu d'une cour fastueuse. On a conservé les ruines de la chapelle, protégées par un arrêté de conservation.
- Dimanche 14.09.1919, les arènes sont pleines et le soleil est ardent. Ce jour là, trois des six taureaux prévus, retenus à la frontière hispano-portugaise par suite de malentendus, n'arriveront pas et la course sera écourtée de moitié Le public furieux scande "Palha est pas là" (c'était le nom de la ganaderia portugaise qui devait les fournir). Puis, fatigués de s'époumoner, voyant tomber la nuit, quelques exaltés jettent pèle-mèle banquettes et chaises au milieu de la piste, y mettent le feu. Il suffira de quelques chaises enflammées lancée sur les gradins ou sous les galeries couvertes de bois pour que les arènes de Lachepaillet soient consumées. Il faudra attendre un an pour qu'elles soient reconstruites et ré ouvertes.
Incendie politique ou par fait de guerre
L'église Sainte-Marie de Bayonne aurait été brûlée, en 864, nous dit Duceré, ainsi que monastères et maisons avoisinantes pour élever un temple à Odin, Dieu de la guerre des Normands.
A son tour St Léon fera tomber le feu du ciel sur les faux dieux et l'on pourra reconstruire l'église .
12 septembre 1916, c'est la terreur dans le quartier de la poudrerie de Blancpignon qui a pris feu et dont les explosions ébranlent Bayonne. (Henri Jeanpierre 1980 SLA Bayonne) .
Un moyen inattendu de propagation est attesté en 1719 lors de l'embrasement de la Tour de Sault. (27.11.1719 DD 156 17). Le soldat de garde constate que la chandelle allumée par ses soins a été enlevée et traînée jusqu'à un amas de paille.
Il juge en conscience que ce sont les gros rats dont il est environné qui s'en sont saisi. La rumeur publique confirmera que des rats sont sortis en foule de la tour lors des premières lueurs de l'incendie.
Bayonne devra donc compter avec ses rats incendiaires !
Les moyens de lutte contre l'incendie : La prévention, l'eau, les seaux, les pompes à incendie et surtout les soldats du feu.
La prévention
- En 1290, l'assemblée des 100 pairs ordonne que toutes les couvertures de chaume disparaissent et soient remplacées par des toitures en tuiles à canal. (Duceré).
Il y a eu assez tôt prise de conscience de la part des autorités, La prévention vise certaines professions réputées "à risque", mais les contrevenants nombreux obligent à reconduire menaces et arrêtés.
- C'est ainsi que l'on pourra obliger des boulangers à démolir leur four à cause du danger immédiat. Ce sera la cas en1709, (DD 156 13), pour deux boulangers dont les fours sont ouverts sur le devant jusqu'au dessus du toit, sans cheminée .
En 1713 un maître fournier doit démolir son four attenant au mur d'un cabaret. La chaleur dégagée fait tourner le vin!(DD114) ( 1724 1731 CC 195)
Boulangers et fourniers devront donc faire ramoner les cheminées de leurs fours tous les 15 jours et, pour que nul n'en ignore, ils feront porter la "suye" sur la rue.
- Les forges posent de gros problèmes et la politique à leur égard changera au long des temps.
Au départ leur activité est cebsée se concentrer dans la rue des Faures où l'on retrouve aussi les taillandiers, cloutiers, cuirassiers, fourbisseurs, fondeurs, potiers d'étain, arbalétriers et arquebusiers. Ce privilège date de 1205 (Ducéré).
C'est ainsi qu'en1673 Jean Pape, forgeron, devra démolir son atelier parce que celui-ci est établi frauduleusement rue Marsan,
Pourtant, vers 1750, on s'efforcera au contraire de les exclure du coeur de la cité. DD 136 , ce qui se fera avec difficulté et madame Pontet en relève encore 22 dans la ville en 1753.
- On tient compte en cela de l'opinion publique. C'est ainsi que, en 1723, le sieur Courthiau qui fait fondre journellement au bourgneuf de la graisse de baleine doit transporter sa chaudière hors la ville "à cause de l'odeur et du danger".
- En 1741 on exigera un ramonage quatre fois par an, principalement à l'entrée de l'hiver. (DD 156.94) . On recevra une amende de 50 livres chaque fois qu'il y aura un feu et le double si le feu a pris pendant la nuit. Comme les amendes seront à partager moitié pour le dénonciateur,moitié pour la ville, et il y a de multiples dossiers à traiter.(DD156 81 ...)
Le ramonage obligatoire était traditionnellement effectué par les charpentiers de maisons, aidés de savoyards qui offraient leurs services, l'hiver. Or, en 1740, deux Savoyards proposent, au Corps deVille, de se fixer à Bayonne à l'année et de « s'y installer toute leur vie », contre le privilège du ramonage. DD 156 ). Il s'agit de Joseph Guillot et d'Aymé Virbé Roullet.
Ils ramonent, disent-ils mieux que les charpentiers sans monter comme eux sur les toits. Chacun d'eux est aidé d'un petit garçon, l'un pendant les mois d'hiver, l'autre toute l'année. Le tarif demandé est de10 sols pour le 1er étage et de 8 sols pour les 3˚ et 4˚ étage. Ils promettent aussi d'être sur les lieux des feux au 1˚ coup de tocsin.
La ville accepte une partie de cette proposition, sans toutefois interdire aux charpentiers de continuer à ramoner les cheminées.
Les revenus des deux Savoyards n'ont pas dû répondre à leur espérance puisque ils cèdent rapidement leurs droits à un "pays", Gaspard Matelay, qui adjoint à ses activités le privilège d'étre le seul qui puisse crier "parsol et parapluie" (DD156 82) et dont il assure les réparations.
DD 157˚.DD 156 23.09.1730.
- En 1889, après l'incendie de l'Hôtel de Ville et des musées, on veille à ne plus regrouper ensemble toutes les ?uvres d'art et les collections.
L'eau. Les Puits
Dans la lutte contre les incendies, la question de l'eau est primordiale.
Or, comme cette ville est fluviale et maritime, il semblerait naturel que ce ne soit pas une denrée qui puisse causer des soucis
Pourtant, pendant longtemps les points d'eau de la ville furent insuffisants et leur débit médiocre. (Mme Pontet Ed.Even...)
- En août 1724 , l'intendant De Lesseville écrit : "Il est d'une nécessité pour ainsi dire indispensable d'avoir une fontaine dans la ville... avec un réservoir au milieu de la place du marché pour satisfaire aux cas imprévus. (DD 159)
Les propositions de fontainiers se succèdent, mais les essais sontdécevants.
En 1769, le corps de ville décide de confier à un fontainier hydrauliste de Paris les travaux de la fontaine de Chauron (DD 106). Ce sera un désastre avec un débit bien inférieur à ce qui était attendu et de plus, le siphon de plomb qui se rompit au bout d'un an, provoqua une importante inondation.
- Les Archives de Bayonne ne disent pas si les Bayonnais ont pu utiliser autre chose que de l'eau pour éteindre un début de feu. En revanche dans le livre des "Etablissements de Dax" on peut relever le cas de figure inattendu d'une personne qui, faute d'eau, se servirait de vin ou de cidre pour éteindre le feu et qui doit donc être indemnisée pour le sacrifice qu'elle a fait en faveur de la communauté
Les seaux, cruches et paniers
- Pour transporter l'eau, la ville paye le 6.10.1696, 92 cruches qui ont servi lors d'un incendie rue Pannecau, ainsi que 6 pelles de bois (DD 156 11).
Elle possède aussi des seaux et paniers dont les modèles en usage dans la première moitié du XX˚ siècle, n'auront pas changés. Ils sont en toile blanche cirée cerclés d'osier, en veau ciré ou en mouton.
En 1741 Christophe Rossi présente une facture pour la peinture de 52 paniers.(DD 156.95)
En 1744 on établit à 186 le nombre des paniers à la charge de l'Hôtel de Ville. Cependant ils ne sont pas en quantité suffisante puisqu'en cette même année, il a fallu aller en chercher d'autres sur les navires. (DD 157)
Aussi la ville rachète 250 paniers neufs en 1777.
Les premières municipalités révolutionnaires en ont commandé 600, mais lorsque on fait un inventaire, le 10 ventôse an 3, il n'y en a plus que 395.
C'est le signe qu'ils ont brûlé ou plutôt, qu'après les incendies, on oublie de les rapporter.
On se plaint déjà de cette attitude en 1740 (DD 156 79 ) Les contrevenants déciouverts, c'est-à-dire dénoncés, devront payer 100 livres d'amende, dont la moitié ira au dénonciateur.
Pompes à incendie.
Comme l'écrit 01.08.1724 l'Intendant de Lesseville (DD159 pièce 31) à la suite d'un incendie rue de la Poissonnerie "Les pompes et les seaux sont une grande ressource...mais il faut savoir s'en servir..."
Ce qui confirme bien que l'organisation des secours reste longtemps du domaine de la sollicitude et de l'affolement
Grand progrès dans la lutte contre les incendies, les pompes à incendie font leur apparition, mais elles sont très rudimentaires
En 1748 on investit dans une grande pompe d'Amsterdam, une petite pompe de Rouen,et deux autres pompes avec leur nécessaire.
Un artisan bayonnais propose, en février 1790, une idée originale qui ne sera pas retenue: il veut construire une pompe traînée par une gabarre (BB 64 )
Les Soldats du feu
Pendant longtemps il n'a fallu compter que sur la bonne volonté de tous les sans grades, souvent victime de leur désorganisation.
Au 17˚ siècle, le salaire de ceux qui remplissent des barriques d'eau, consiste en pots de vin et en quignon de pain (DD 156 11 et 12).
Peu à peu l'armée intervient de façon régulière, à l'appel du tocsin (1736).
En 1737, les pompes nouvellement achetées demandent une maintenance. Trois Bayonnais sont chargés de leur entretien et de leur exercice en cas d'incendie" : Guillaume Boubée, puis son fils Pierre; Christophe ROSSI et Etienne CABARRUS, voilier qui entretient aussi les seaux.
En 1741, une ordonnance de Dulivier s'adresse à tous les maçons, charpentiers, recouvreurs et ramoneurs pour qu'ils se rendent, u premier signal, à l'endroit où sera le feu, à peine de 10 livres d'amende contre chaque défaillant.
En 1744, les pompes sont en service, et pourtant les soldats de la garnison restent armés de cruches pour remplir les seaux, afin d'éteindre le feu
le 09.08. 1793 ( Chambre de commerce J 15) établit l'ordre à observer par la garde nationale en cas d'incendie alors qu'on bat la générale. La réglementation est plus précise mais toujours peu efficace.
En 1804 on signale que les militaires et les charpentiers réussirent à isoler le foyer de l'incendie et que les pompes furent actionnées "avec intelligence". (M.Hourmat ) Il y a un réel progrès !
Les conséquences des Incendies sont traumatisantes
Les dégâts de l'incendie de 1736 par exemple, se chiffrent, chez les particuliers à plus de 636 000 livres (DD160 21 31.10.1736) avec la ruine totale de beaucoup d'entre eux.
A côté de cette détresse des particuliers, les autorités exigent tout naturellement les remboursements de leurs propres dépens.
Il faudra, par exemple, payer les frais de détachage au capitaine qui a sali son habit en 1744 (DD 157).
Le pilote de rivière Guillaume Gabarret, se fait rembourser une gaffe incendiée ( DD 157) et le 17.03.1746 on remplace pour Gracy de Lesseps, hospitalière de l'hôpital militaire, 8 cruches cassées que les échevins ont pris pour éteindre le feu, et on doit lui rembourser un blanchissage du linge extraordinaire, etc. (DD.157 15.05.1744).
A côté de cela aucune assurance n'existe pour les propriétaires, encore moins pour les locataires.
Nous sommes loin du régime inventé dès 1666 en Angleterre. C'est lorsqu'un incendie de 7 jours et 8 nuits y a détruit 13.200 bâtiments dont 87 églises, que l'aubergiste Edouard Lloyd a conçu un office d'Assurances Générales (la Lloyd actuelle).
En France, et à Paris, il faudra semble-t'il attendre 1717 pour trouver les balbutiements d'un bureau des incendies. La chambre d'Assurances Générales contre l'incendie de Paris en 1753 et la Compagnie Royale d'Assurances de 1786 disparaîtront à la Révolution.
Mais en 1736 et en province aucune indemnité n'est prévue pour les victimes du feu.
Et comme toujours, hélas, l'aubaine du pillage, latente, côtoie les actes d'héroïsme. Les archives parlent de "Ceux qui profitent du trouble et de la confusion que causent les incendies".
Après le drame de 1736, on dénombre l'enlèvement sous prétexte de les sortir des flammes, de meubles, marchandises et argent, bijoux . .. que l'on a jamais revus.
En 1744, lors de l'incendie de la maison Hontabat, rue Bourgneuf, les seuls objets que l'on a officiellement retirés du sinistre sont 3 paires de pistolets, un missel romain , 2 paires de bas noirs et un carré de coton
Quant aux morts , ils sont anonymes. Impossible de faire un état des hommes, femmes, enfants, sauveteurs qui furent brûlés vifs (1736 DD 156) . Ils représentent pourtant l'aspect humain le plus important et l'enjeu d'une lutte qui prend là toute sa dimension.
De nos jours la prévention est le maître mot des sapeurs-pompiers. Grâce à la généralisation des matériaux ignifugés et des détecteurs, la lutte contre l'incendie n'est plus leur fonction principale.
Pour 1999, sur les 8495 interventions dénombrées sur le district du B.A.B. 382 seulement concernent des incendies, les autres sorties faisant l'objet d'une ventilation précise.
Actuellement, le Centre de Secours Principal dispose de
4 ambulances,
2 fourgons pompe-tonne lourds de 3000 litres
2 fourgons pompe-tonne légers de 2000 litres
2 camions citernes pour feux de forét
2 véhicules pour désincarcération
2 échelles mécaniques aériennes de 18 et 30 mètres
1 véhicule pour le risque chimique
et un parc automobile de voitures réparti entre le Centre Principal d'Anglet et les centres de secours
de Bayonne et de Biarritz.
La caserne principale compte 106 sapeurs pompiers professionnels, 83 volontaires, 2 personnes
attachées au secteur administratif.
Tous bénéficient de formations continues et d'un entraînement sportif de haut niveau. Certains sont plongeurs, sauveteurs en mer et disposent d'embarcations rapides, de pneumatiques style Zodiac ou de Jet-Ski pour les interventions sur la côte.
D'autres sont spécialisés pour le risque chimique, d'effondrement, pour les accidents radiologiques,
...etc.
On est bien, bien loin des soldats porteurs de cruches ou de seaux mais, au long des siècles c'est la même ardeur qui les porte à secourir leurs semblables et la même force d'âme. Ils doivent rester fermes et lucides dans des ambiances de cauchemars
Un décompte qui ne sera jamais fait non plus, c'est le nombre de vies épargnées grâce à leur dévouement !
Leur grand souci actuel est de prévenir et éviter tout incendie dans le vieux Bayonne historique, dont les maisons échappent encore aux normes de sécurité, mais apportent tant de charme à cette belle ville.
Anne-Marie Bellenguez
pour :"L'Adour maritime de Dax à Bayonne" 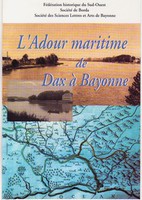
Actes du LIIIème congrès d'études régionales de la Fédération historique du sud-ouest,tenu à Dax et à Bayonne, les 27 et 28 mai 2000.
(Fédération historique du Sud-Ouest; Société de Borda;
Société de Sciences lettres et arts de Bayonne)
